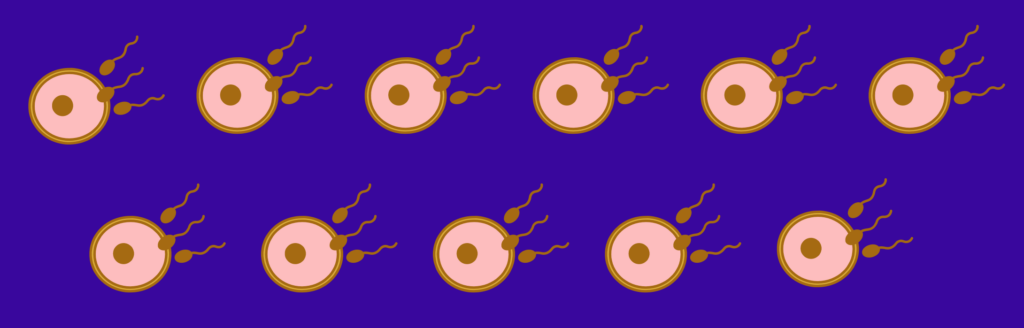C’est quoi la préservation d’ovocytes ?
La préservation d’ovocytes est une méthode qui permet à une femme de congeler ses ovocytes afin de les utiliser ultérieurement, si elle souhaite avoir un enfant. Avec l’âge, la qualité et la quantité des ovocytes diminuent, ce qui peut réduire les chances de grossesse. Cette technique permet donc de préserver sa fertilité, que ce soit pour des raisons médicales ou personnelles. Pour réaliser cette préservation, la femme suit un protocole de stimulation ovarienne à l’aide de médicaments hormonaux. Les ovocytes sont ensuite prélevés lors d’une intervention médicale, sous anesthésie locale ou générale. Les ovocytes matures sont ensuite congelés (vitrifiés) à très basse température dans un laboratoire spécialisé. Ils pourront être utilisés ultérieurement dans le cadre d’un projet de grossesse.
Durant mon processus de préservation d’ovocytes, j’ai ressenti à de nombreux moments de la solitude, ainsi que le besoin d’échanger et de lire des témoignages. En effet, je voulais mieux comprendre ce qui se passait dans mon corps, et savoir si ce que je ressentais était normal. J’ai donc effectué plusieurs recherches sur Internet afin de trouver des témoignages qui m’auraient permis de me sentir moins seule face à ce que je vivais et ressentais. J’ai constaté qu’il y en avait très peu. Il existe davantage de récits sur le parcours de FIV, qui est désormais plus courant et beaucoup plus partagé. Même si certaines étapes peuvent être similaires, la préservation d’ovocytes reste moins évoquée, alors qu’un grand nombre de femmes y ont recours pour des raisons diverses. J’ai donc éprouvé le besoin de partager mon histoire et mon expérience lors de ma préservation d’ovocytes.
Je précise que ce vécu reste très personnel, et que chaque situation est unique. Le déroulement d’une préservation d’ovocytes peut varier en fonction de la pathologie de chacune, du contexte médical, ainsi que de l’établissement dans lequel elle est réalisée. Ce que je partage ici reflète mon expérience, mais ne correspondra pas nécessairement à celle de toutes les femmes.
Pourquoi ai-je choisi de préserver mes ovocytes ?
Comme je l’ai évoqué l’article sur mon parcours avec l’endométriose, c’est mon urologue, le médecin qui m’a diagnostiquée, qui m’a parlé pour la première fois de la préservation d’ovocytes. J’avais 27 ans, j’allais en avoir 28 quelques mois plus tard. J’ai d’abord assez mal pris son discours : « Est-ce que vous avez pensé à avoir des enfants ? Vous êtes au meilleur âge pour en faire. Après, la réserve d’ovocytes peut commencer à diminuer, et cela peut devenir plus difficile, surtout avec l’endométriose. Si ce n’est pas le cas, vous devriez penser à la préservation d’ovocytes. » Tout à coup, la question des enfants s’est réellement posée. La notion d’horloge biologique et la pression de la société sont venues s’immiscer dans ma tête. J’ai essayé de mettre tous ces questionnements de côté, car je me disais que j’avais encore le temps. Mais la réalité, c’est que pour moi, le poids de l’endométriose, les chiffres, les témoignages de femmes rencontrant des difficultés à concevoir ont toujours été présents et ont eu un impact sur mon choix de réaliser ma préservation d’ovocytes.
Avant la loi du 2 août 2021, la préservation d’ovocytes était réservée aux personnes dont la prise en charge médicale était susceptible d’altérer la fertilité. L’endométriose pouvait faire partie de ces raisons médicales. Mais le 2 août 2021, une nouvelle loi relative à la bioéthique a ouvert la vitrification ovocytaire à toutes les femmes âgées de 29 à 37 ans, souhaitant préserver leur fertilité sans indication médicale.
La question de faire un enfant reste pour moi une question très personnelle. Elle représente en effet une décision individuel et de couple. Comme je l’ai mentionné plus haut, à l’approche de mes 30 ans, cette question occupait de plus en plus mes pensées. Le désir d’être mère et de fonder une famille est quelque chose de fondamental pour moi. Mais la crainte de ne pas y parvenir à cause de l’endométriose m’a poussée à exercer ce droit que les femmes ont désormais : celui de pouvoir préserver leurs ovocytes.
Comment débuté un parcours de préservation d’ovocyte ?
Je me suis, dans un premier temps, renseignée auprès de ma médecin généraliste. Nous avons fait le point, à l’aide d’une prise de sang, sur les différents marqueurs de la fertilité. Elle a bien sûr tenu un discours rassurant concernant la notion de temps et ma réserve ovarienne, qui était dans les normes. Ma médecin m’a donc orientée vers un gynécologue spécialisé PMA/FERTILITE et endométriose. À ce stade, je n’avais pas encore de gynécologue attitré assurant mon suivi pour ma pathologie.
Après avoir commencé mon suivi avec ce gynécologue, discuté de mon endométriose, récupéré toutes les informations sur la préservation d’ovocytes, et bien sûr pris quelques mois de réflexion. En effet, mes premières pensées été que je ne voulais pas faire subir tout cela à mon corps, qui avait déjà suffisamment souffert avec l’endométriose mais j’ai fini par me décider. Lorsque j’étais enfin prête à me lancer dans le processus de préservation, le premier hôpital vers lequel m’avait orientée mon gynécologue ne prenait plus de patientes. Actuellement, il y a bien plus de demandes que de places disponibles dans les hôpitaux, ce qui rend l’attente assez longue. Je me suis donc tournée vers le deuxième hôpital que mon gynécologue m’avait recommandé. Grâce à mon dossier et à une lettre d’adressage, j’ai pu entamer mon parcours et obtenir un premier rendez-vous, alors que je n’avais que 28 ans.
Le processus, relativement long, m’a offert l’opportunité d’échanger à chaque étape avec les différents professionnels, tout en me laissant le temps de réfléchir. Cela m’a permis, au fil des mois, de confirmer ma décision et d’être pleinement certaine de vouloir me lancer dans ce projet important. J’ai également été accompagnée à chacun de mes rendez-vous, et tout au long du processus, par mon conjoint. Sa présence m’a apporté un véritable soutien, à la fois physique et psychologique.
Les premières étapes du parcours de préservation
J’ai effectué ma préservation d’ovocytes au Centre Hospitalier des Quatre Villes, situé à Saint-Cloud, en proche banlieue parisienne. Aujourd’hui, plusieurs établissements publics et privés réalisent des préservations d’ovocytes. Il est toutefois essentiel de s’orienter d’abord vers un gynécologue, qui pourra vous adresser vers un centre spécialisé et reconnu.
C’est en janvier 2023 que j’ai commencé mes démarches et pris contacte avec le centre hospitalier. J’ai ainsi obtenu un premier rendez-vous pour mai 2023 soit 5 mois plus tard.
Le premier rendez-vous :
Lors de ce rdv j’ai rencontré une gynécologue avec qui j’ai pu échanger à propos de mon dossier médical et des raisons qui me poussaient à envisager une préservation d’ovocytes. J’étais alors à un mois de fêter mes 29 ans, soit l’âge minimum fixé par la loi pour accéder à la préservation sans motif médical. Étant donné mon jeune âge et ma bonne réserve ovarienne malgré l’endométriose, le service a décidé de m’orienter vers le parcours standard. Cela signifie que je n’ai pas bénéficié de délais accélérés, comme cela peut être le cas lorsque la réserve ovarienne est déjà diminuée, ou dans des situations médicales urgentes nécessitant une préservation rapide avant un traitement susceptible d’affecter la fertilité. Je suis repartie de cet entretien avec de nouveaux examens à faire pour vérifier ma réserve ovarienne, incluant une prise de sang et une échographie. Il peut également, dans certains cas, y avoir des examens complémentaires, mais cela dépend de chaque cas. C’était donc à moi, quelques mois plus tard, de reprendre contact avec le service pour confirmer mon envie de réaliser cette préservation.
Après plusieurs mois de réflexion supplémentaires, j’ai pris ma décision finale en septembre 2023. J’ai donc obtenu un deuxième rendez-vous pour janvier 2024.
Le deuxième rendez-vous :
Lors de ce deuxième rendez-vous, la gynécologue a fait le point sur les différents examens réalisés entre les deux rendez-vous afin de déterminer mon protocole de ponction. Cela correspond aux médicaments qui seront administrés ainsi qu’à leurs dosages. J’ai suivi un protocole utilisant Sanyrel, Ovaleap et Ovitrelle. Les dosages inscrits sur les protocoles restent des dosages prévisionnels et sont ajustés au fur et à mesure de la tentative, après chaque examen réalisé (prise de sang et échographie). Bien que je suppose que le déroulement de la préservation reste globalement similaire, les traitements et dosages utilisés dépendent toutefois du gynécologue et de l’hôpital.
Lors de ce rendez-vous, il m’a également communiqué la date de la ponction ainsi que les différentes étapes à suivre avant celle-ci. Pour ma part, j’ai attendu 10 mois. En effet, puisque mon rendez-vous était en janvier 2024, j’ai commencé le traitement en novembre et la ponction des ovocytes a été programmée pour décembre 2024.
Les recommandations générales suggèrent de congeler en moyenne 15 ovocytes pour que la préservation soit efficace et maximiser les chances d’une grossesse future. Ce nombre prend en considération la perte possible à la suite de la décongélation et l’option de réaliser plusieurs tentatives de fécondation. Selon le nombre d’ovocytes matures obtenus lors de la première ponction, un deuxième cycle de stimulation peut être proposé pour atteindre ce nombre optimal. Cependant, dans mon cas, cette possibilité d’un deuxième cycle a été très peu abordée. Il est également important de distinguer entre le nombre d’ovocytes prélevés lors de la ponction et le nombre d’ovocytes matures qui sont ensuite vitrifiés.
Je suis donc partie stressée, impatiente mais optimiste, avec l’idée d’obtenir 15 ovocytes dès la première tentative, et j’ai attendu patiemment le mois de novembre pour débuter mon processus.